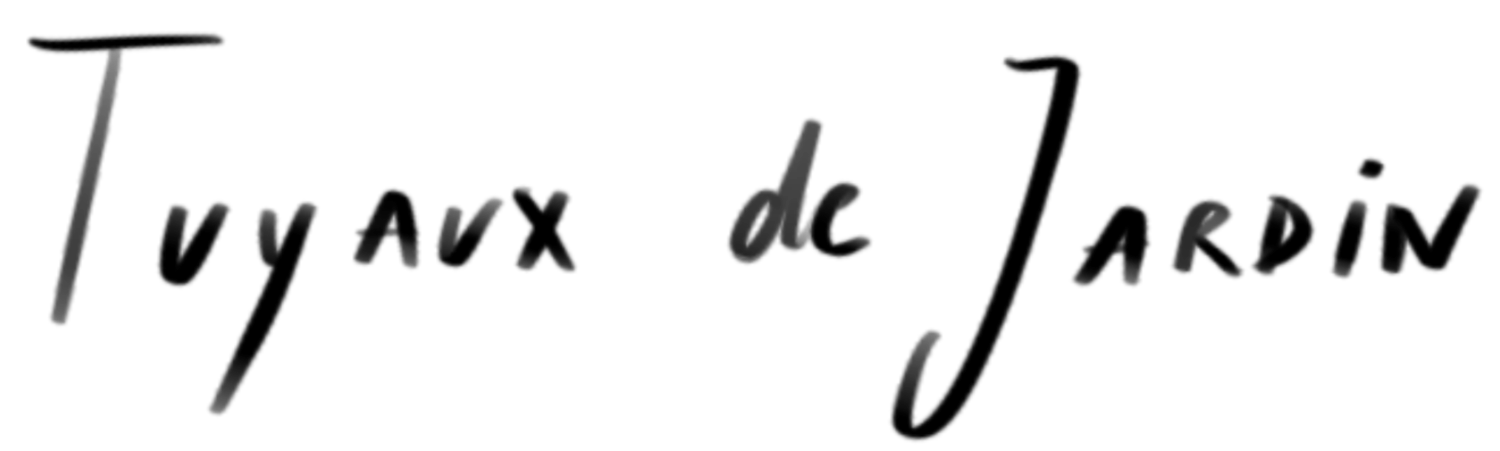les étoiles blanches du printemps
Quand on parle de bulbes de printemps, ce sont souvent les grosses jonquilles jaunes qui nous viennent à l’esprit. Or beaucoup n’ont pas d’affinités avec le jaune. Voici donc une sélection de charmants bulbes blancs qui prendront le relais des perce-neige. Certains se multiplient facilement dans le gazon, le parsemant de petites étoiles brillantes.
Ipheion
Commençons par Ipheion pour la simple raison qu’on le nomme communément l’étoile du printemps. L’espèce cultivée est Ipheion uniflorum, portant une seule fleur par tige. Ce charmant bulbe est originaire du nord de l’Argentine et de l’Uruguay, où il peut former de vastes colonies dans les prairies. Un feuillage étroit apparaît dès décembre. Il sent légèrement l’ail et est comestible. Les fleurs à 6 pétales, toutes blanches avec un petit coeur or, sont produites dès mars et peuvent s’élever jusqu’à 40 cm. De belles touffes se forment en quelques années et peuvent alors être divisées.
Comme pour la plupart des bulbes, un position ensoleillée et un sol drainant sont recommandés. L’étoile du printemps peut être plantée dans le gazon car son feuillage disparaît avant l’été, eu moment de la tonte.
Les sélections blanches ‘Spring Star’ et ‘Alberto Castillo’ sont particulièrement lumineuses, mais des variétés bleues ou roses sont également proposées.
Puschkinia
Cette petite bulbeuse de charme n’a pas été dédiée au grand poète russe mais à un botaniste qui vous est certainement inconnu. Vers 1800, Apollon Mussin-Puschkin, russe lui aussi, arpentait le Caucase d’où il introduisit ce bulbe.
Par divers aspects le Puschkinia ressemble aux jacinthes sauvages, les scilles, ce qui vaut à l’espèce le nom de Puschkinia scilloides. La feuille en particulier rappelle celles des jacinthes.
Le type est d’un bleu très pâle inhabituel. La sélection ‘Alba’ est blanc pur. Elle s’implante dans l’herbe et se naturalise volontiers.
Pour semer la confusion, s’il y a le Puschkinia scilloides, il existe aussi un Scilla puschkinoides! Celui-ci appartient aux domaines des bulbes rares, tels que proposés par Nijssen Bulbs.
Scilla siberica
Très semblable au Puschkinia, cette petite étoile-ci provient aussi du Caucase, contrairement à ce que son nom indique. Comment les distinguer? Il faudra se mettre à genoux et se munir d’une loupe! Alors que chez le Puschkinia les étamines sont fusionnées pour former un tube, chez la scille de Sibérie elle sont bien visibles et séparées. De plus, le pollen est bleu foncé! Si vous n’êtes pas apiculteurs, vous pensez probablement que le pollen est toujours jaune ou orange. Or toutes les couleurs existent: noir, vert, bleu, rouge, blanc …
La scille de Sibérie de base est bleue. Celle ci-dessus est la variante blanche ‘Alba’. Elle se propage facilement dans l’herbe.
Ornithogalum umbellatum
Cette petite star ci est en revanche bien de chez nous, principalement du sud de l’europe. Le nom curieux d’ornithogale provient des mots grecs ornithos, l’oiseau (pensez à l’ornithologie) et gala, le lait. Serait-ce simplement pour la couleur blanche, ou parce que le lait d’oiseau serait une merveille? On n’en sait rien. Toujours est-il que le nom existait déjà dans l’Antiquité.
Il y a des nombreuses espèces de ce bulbe que vous pouvez cultiver, souvent très belles, notamment Ornithogalum nutans, l’étoile de Jérusalem. Chez l’espèce umbellatum ci-dessus, les ombelles peuvent porter jusqu’à 20 fleurs en étoile blanc pur. Le feuillage touffu, qui apparaît dès janvier, est fin et retombant, ressemblant à de l’herbe. Cet ornithogale se répand par semences dans les situations qui lui plaisent: au sec et au soleil. Ses petites étoiles blanches, marquées d’une grande ligne verte au revers, attendent d’ailleurs que le soleil soit haut dans le ciel pour s’ouvrir. Cela lui vaut le nom vernaculaire de dame-de-onze-heures. Avec ses 30 cm de haut, cette plante est plus visible que les miniatures précédentes. Sauvage et charmante, elle mérite une place dans les jardins de tous les styles.
Leucojum
Elles portent plutôt des clochettes que des étoiles, mais comment ne pas promouvoir les ravissantes nivéoles, fleurissant elles aussi en début de saison. Il y a essentiellement deux espèces que l’on cultive, la printanière et l’estivale.
Leucojum vernum (ver is le printemps en latin) est la première à fleurir, dès février. Cette petite bulbeuse, ressemblant fort à un perce-neige, est originaire d’Europe et notamment d’ex-Yougoslavie. Les 6 pétales formant la clochette sont de même longueur, contrairement au perce-neige, et clairement marquées d’une petite pointe jaune. Avec le temps, ces nivéoles peuvent former de belles colonies mais il leur faut un terrain bien humide. Elle reste peu courante.
Leucojum aestivum est la nivéole d’été, mal nommée car elle fleurit en mars-avril. Ici les 6 tépales blancs sont clairement marqués d’une tache verte à l’extérieur et à l’intérieur. Les tiges portent plusieurs clochettes pendantes, dont l’effet est très gracieux. Chez la sélection ‘Gravetye Giant’, nommée pour un des grands jardins anglais, les tiges peuvent atteindre 50 cm de haut. Ceci en fait un fleur à couper épatante à une saison où les narcisses commencent à peine. Les bulbes forment assez vite de belles touffes mais, de mon expérience, ne se multiplient pas par semis. Pour obtenir une masse, il convient donc de diviser les touffes après la floraison et de replanter les bulbes individuels avec les feuilles (comme pour les narcisses ou les perce-neige).
Il existe encore d’autres charmants petits bulbes en version blanche: Chionodoxa, crocus, muscaris…Plantés en masse dans un sous-bois ou une prairie, ces petites étoiles de printemps produisent un effet ravissant. Le seul problème est que pour obtenir un résultat comme ci-dessus (et ce n’est pas chez moi) il aura fallu planter des centaines de mini bulbes … un par un!